Interception routière aléatoire : la Cour d’appel du Québec déclare inopérant l’article 636 du Code de la sécurité routière
P.G.Q. c. Luamba, 2024 QCCA 1387

La Cour d’appel du Québec estime que l’art. 636 du Code de la sécurité routière autorisant les interceptions routières aléatoires entraîne le profilage racial. Cette règle de droit viole les art. 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne peut se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier.
La réparation appropriée est une déclaration d’invalidité fondée sur le par. 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982 dont la prise d’effet est suspendue pour une durée de six mois, sauf en ce qui concerne les dossiers en cours dans lesquels l’art. 636 C.s.r. est contesté.
Violation de l’art. 9 Ch. can. qui ne se justifie pas au regard de l’article premier
« [74] […] Le profilage racial dans les interceptions routières sans motif requis est causé par le fait que l’art. 636 C.s.r. ne comporte aucun critère permettant d’encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il confère aux policiers. En l’occurrence, le problème réside dans l’absence de limites adéquates dans la loi quant à l’exercice de ce pouvoir. C’est cette absence de balises suffisantes à l’article 636 C.s.r. qui, en favorisant le profilage racial, est la source des violations alléguées de la Charte.
[…]
[134] […] [P]our le juge Sopinka [dans l’arrêt Ladouceur,] le pouvoir absolu d’intercepter au hasard un conducteur au cours d’une patrouille n’est pas un « ajout nécessaire aux nombreuses méthodes d’application des lois déjà disponibles ». Il note que les programmes structurés de contrôles routiers ponctuels (qui atteignent déjà, selon lui, « les limites extrêmes de l’article premier ») permettent de servir les fins de l’application de la loi tout en étant moins envahissants et moins susceptibles de donner lieu à des abus que le pouvoir absolu qu’on cherche à justifier. La Cour est d’avis que le passage du temps a démontré que les craintes du juge Sopinka étaient fondées.
[135] Notons par ailleurs que les policiers disposent aussi d’autres pouvoirs leur permettant d’intervenir auprès de conducteurs pour des considérations de sécurité routière ou publique. Par exemple, ils peuvent validement intercepter un véhicule en vertu de leur pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un conducteur est impliqué dans un crime donné et qu’il est nécessaire de le détenir. La doctrine des pouvoirs accessoires issue de la common law autorise également l’interception d’un véhicule lorsque cela « est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances ». L’unique « ajout » de l’art. 636 C.s.r. est d’habiliter les policiers à contrôler les conducteurs sans motif requis, en dehors d’un programme structuré.
[136] N’ayant offert aucune justification sur la nécessité d’octroyer aux policiers un pouvoir discrétionnaire presque illimité, le PGQ ne fait pas la démonstration que le juge fait erreur en concluant que d’autres stratégies pour atteindre l’objectif législatif sont disponibles et permettent d’arriver au même résultat (comme des barrages routiers, des programmes de sécurité routière désignés et encadrés, des initiatives de sensibilisation du public et des méthodologies permettant de s’assurer que les interceptions sont réellement aléatoires plutôt que discriminatoires).
[…]
[138] Le PGQ ayant échoué à démontrer que le moyen utilisé pour atteindre l’objectif poursuivi par l’art. 636 C.s.r. ne constitue pas une atteinte minimale au droit fondamental garanti par l’art. 9 de la Charte, cette atteinte ne peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte. »
Violation de l’art. 15 Ch. can. qui ne se justifie pas au regard de l’article premier
Première étape : démontrer que la loi crée, à première vue ou par son effet, une distinction fondée sur un motif protégé
« [176] Comme le note le juge de première instance, « la règle de droit contestée est d’apparence neutre puisqu’elle permet à la police d’intercepter n’importe quel véhicule à l’aveugle, sans motif, ni soupçon, pour une vérification de routine ». Dans les faits, cependant, elle a une incidence nettement disproportionnée sur les conducteurs noirs (par rapport aux autres groupes de conducteurs, notamment les conducteurs blancs).
[…]
[185] […] l’expert Mulone conclut que « les personnes noires sont visées de manière disproportionnée par les forces de l’ordre au Canada », notamment dans le cadre des interceptions routières sans motif requis. Il souligne l’absence d’études montrant « des résultats contraires à ces fortes réitérations temporelle et géographique de[s] disparités de traitement » vécues par les personnes noires. Il rejette sans ambages la « théorie de la pomme pourrie » : pour lui, il ne fait aucun doute que le problème est structurel (systémique) et relève du profilage racial.
[186] La preuve de l’experte Sylvestre va dans le même sens que celle de l’expert Mulone. Elle conclut elle aussi que les personnes noires sont davantage interceptées (et interpellées) que les personnes blanches et qu’elles font l’objet de profilage racial dans les interceptions routières sans motif requis. À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de son projet de recherche sur le profilage racial dans les interceptions routières, elle conclut à « une utilisation abusive du pouvoir discrétionnaire des policiers et [à] l’utilisation de prétextes et de ruses qui sont des indicateurs clairs de profilage racial ».
[…]
[191] […] [D]ans l’arrêt Le, la Cour suprême reconnaît que « [l]es membres des minorités raciales font l’objet d’un nombre disproportionné de contacts avec la police et le système canadien de justice pénale ».
[192] Ainsi, le juge ne commet pas d’erreur en répondant par l’affirmative à la question de savoir si la règle de droit contestée crée, par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré, soit la race. […] »
Deuxième étape : démontrer que la loi impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage
« [194] Selon la Cour, la preuve démontre également que l’effet préjudiciable causé par l’art. 636 C.s.r. renforce, perpétue et accentue le désavantage (historique et systémique) subi par les personnes noires.
[…]
[197] La preuve d’expert, la littérature scientifique et les rapports de commissions gouvernementales démontrent que le profilage racial dans les interventions policières (dont les contrôles de routine ou les interceptions routières « aléatoires ») a des conséquences multiples et profondes pour les personnes ciblées. […]
[198] […] Dans l’arrêt Le, la Cour suprême reconnaît que « [l’]effet des interventions policières excessives à l’égard des minorités raciales et du fichage des membres de ces collectivités, en l’absence de tout soupçon raisonnable de la tenue d’une activité criminelle, constitue plus qu’un simple désagrément ». Selon la Cour suprême, ce type de pratique « a un effet néfaste sur la santé physique et mentale des personnes visées et a une incidence sur leurs possibilités d’emploi et d’éducation », en plus de « contribue[r] à l’exclusion sociale continue des minorités raciales, [de] favorise[r] une perte de confiance dans l’équité du système de justice pénale et [de] perpétue[r] la criminalisation ».
[199] Quant à l’effet discriminatoire de la distinction, la preuve démontre que le profilage racial a pour effet de perpétuer et de renforcer la discrimination à l’égard des personnes noires. L’expert Mulone décrit bien la dynamique qui sous-tend les interventions policières proactives (comme les interceptions routières sans motif requis) et la « logique de cercle vicieux » qui fait en sorte que les discriminations raciales vont engendrer d’autres discriminations raciales. [….]
[…]
[203] En résumé, une preuve abondante établit que l’art. 636 C.s.r. a pour effet de créer une distinction fondée sur un motif énuméré au par. 15(1), soit la race, et qu’il agit d’une manière qui a pour effet de renforcer, perpétuer ou accentuer le désavantage subi par les personnes de race noire. L’atteinte au droit à l’égalité garanti par le par. 15(1) est donc démontrée.
[…]
[205] […] [L]a Cour est d’avis que l’objectif de l’art. 636 C.s.r. est urgent et réel et que le moyen choisi par le législateur, c’est-à-dire le fait d’autoriser les interceptions routières sans motif requis, présente un lien rationnel avec cet objectif. Il n’est toutefois pas satisfait au critère de l’atteinte minimale. »
[Références omises]
Décision complète disponible ici
***
✨ Inscrivez-vous à ma veille juridique pour être informé des plus récentes décisions prononcées par la Cour suprême du Canada ainsi que les décisions d’intérêt pour les avocat(e)s-criminalistes rendues par la Cour d’appel du Québec.




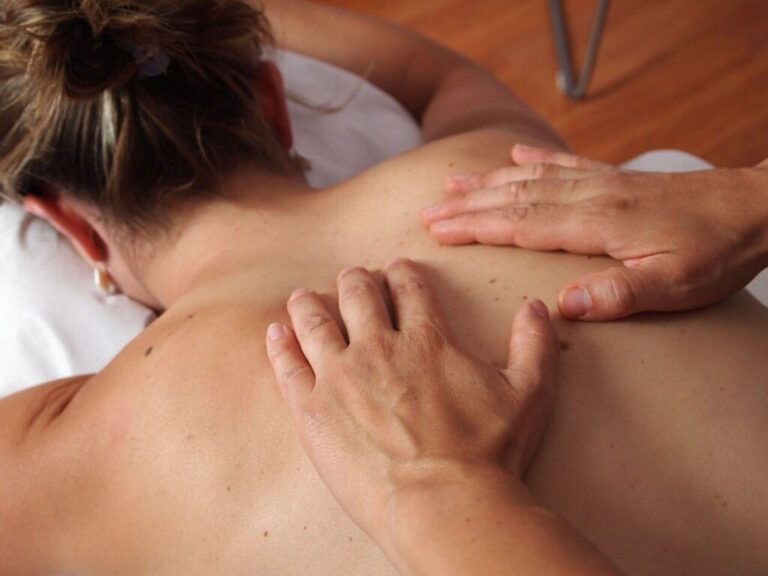


 Aimeriez-vous être informé gratuitement des décisions prononcées par la Cour suprême du Canada en matière criminelle ainsi que des décisions d’intérêt pour l’avocat(e)-criminaliste rendues par la Cour d’appel du Québec?
Aimeriez-vous être informé gratuitement des décisions prononcées par la Cour suprême du Canada en matière criminelle ainsi que des décisions d’intérêt pour l’avocat(e)-criminaliste rendues par la Cour d’appel du Québec?