Une thérapie pour « abuseurs sexuels » ne peut pas être imposée dans le cadre d’une probation sans lien établi entre la problématique, la protection de la société et la réinsertion de l’accusé
M.L. c. R., 2025 QCCA 1035

Reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait par étranglement, l’accusé est condamné à une peine de 729 jours de détention assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, comprenant notamment l’obligation de suivre et de compléter avec succès une thérapie pour « abuseurs sexuels ».
La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en imposant une telle thérapie en l’absence de lien entre cette problématique, la protection de la société et la réinsertion sociale de l’accusé, tel que requis à l’al. 732.1(3)(h) C.cr.
De plus, en accordant un poids excessif à l’absence d’une telle thérapie spécifique entamée lors de l’imposition de la peine, le juge de première instance sous-estime les démarches de réhabilitation déjà entreprises par l’accusé, ce qui contribue à rejeter à tort l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
[50] […] [L]es alinéas 732.1(3)g) et h) C.cr. prévoient certaines conditions de probation facultatives :
732.1 […]
Conditions facultatives
(3)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
[…]
g)si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;
[…]
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
[51] […] [E]n ce qui concerne l’alinéa 732.1(3)g) C.cr., il n’existe pas de programme formel de traitement au Québec. Aucune preuve n’a par ailleurs été administrée au sujet d’un tel programme ni du consentement de l’appelant à s’y soumettre ou d’une acceptation du directeur du programme envisagé par cette disposition. Celle-ci ne peut donc trouver application en l’espèce.
[52] En ce qui concerne l’alinéa 732.1(3)h) C.cr., dans l’affaire R. c. Proulx, la Cour suprême expliquait que dans le cadre du sursis à l’emprisonnement, le juge qui détermine la peine peut ordonner au délinquant de suivre un programme de traitement, que ce dernier y consente ou non, mais qu’il en va autrement dans le cadre d’une ordonnance de probation étant donné que, dans ce dernier cas, le juge ne peut prononcer une ordonnance de participation à un programme de traitement qu’avec le consentement du délinquant (exception faite des programmes de traitement pour abus d’alcool ou de drogue).
[53] Dans l’affaire R. v. Rogers, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique concluait qu’une ordonnance de probation qui obligeait l’accusé à suivre un traitement psychiatrique ou à prendre des médicaments constitue par ailleurs une restriction déraisonnable de sa liberté et de sa sécurité et qu’elle s’avérait contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, sans qu’elle puisse être sauvegardée par l’article premier. Plus tard, la Cour d’appel de la Saskatchewan, dans l’arrêt R. c. Kieling, adoptait ce même principe. Ce sont ces arrêts qui ont d’ailleurs mené à l’adoption de l’alinéa 732.1(3)g) C.cr.
[…]
[55] […] [D]ans R. c. Shoker, la Cour suprême traite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel prévu au paragraphe 732.1(3) C.cr., au moment d’établir des conditions de probation individualisées. Elle y affirme que le juge chargé de la détermination de la peine est bien placé pour concevoir des conditions adaptées au délinquant particulier, qui l’aideront dans sa réadaptation et contribueront à protéger la société et elle précise que le pouvoir résiduel prévu à l’alinéa 732.1(3)h) fait état d’« autres conditions raisonnables » destinées à « assurer la protection de la société et [à] faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». Néanmoins, il demeure que la condition imposée doit être « raisonnable » dans les circonstances et qu’elle doit viser à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant en question, sans revêtir un caractère punitif. Les conditions raisonnables sont généralement, mais non nécessairement, liées à l’infraction en cause et il doit néanmoins y avoir un lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant.
[56] Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun lien de la sorte n’a été établi. Il n’est pas possible de conclure que l’appelant a consenti à suivre une thérapie pour abuseurs sexuels. Tout au plus, lorsque questionné par l’avocate de l’intimé lors de l’audience sur la peine, l’appelant s’est-il dit ouvert à un « suivi sexologique », après avoir admis qu’il trouvait les femmes trop belles et qu’il consacrait un temps démesuré à naviguer sur des sites de rencontres en ligne. Il n’a cependant jamais été question de « thérapie pour abuseurs sexuels » et il m’est impossible de conclure que le suivi sexologique évoqué de manière évasive par le poursuivant était de cette nature.
[57] Avec égards, le juge d’instance ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure qu’une telle thérapie était nécessaire pour éviter le risque de récidives et, au surplus, il ne pouvait certainement pas imposer à l’appelant une thérapie de ce type dans le cadre d’une ordonnance de probation, sans son consentement exprès, alors même que le lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant n’avait pas été démontré et qu’il s’agit d’un prérequis pour émettre une telle condition selon l’alinéa 732.1(3)h) C.cr..
[58] L’erreur du juge d’avoir considéré que l’appelant ne serait engagé sur la voie de réhabilitation que s’il suivait une thérapie pour « abuseurs sexuels » a eu pour effet de minimiser l’importance des thérapies entreprises et terminées avec succès par l’appelant, de sous-estimer sa démarche de réhabilitation et de faire prédominer les objectifs de dissuasion et de dénonciation, l’entraînant ainsi à conclure à tort que le sursis était inapproprié en l’espèce.
Décision complète disponible ici
***
✨ Inscrivez-vous à ma veille juridique pour être informé des plus récentes décisions prononcées par la Cour suprême du Canada ainsi que les décisions d’intérêt pour les avocat(e)s-criminalistes rendues par la Cour d’appel du Québec.

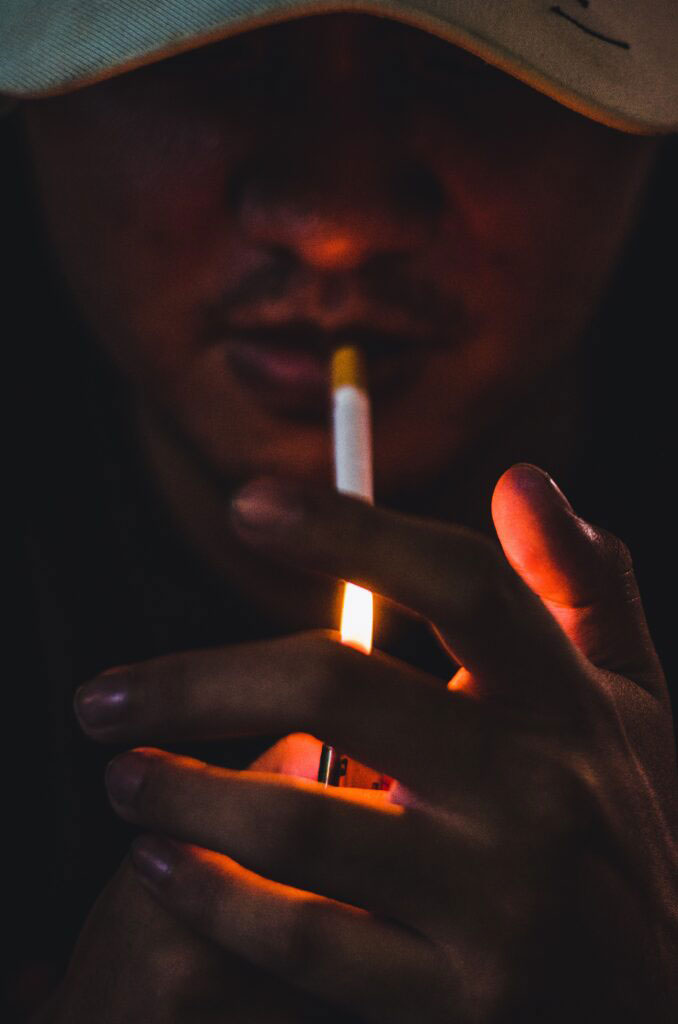





 Aimeriez-vous être informé gratuitement des décisions prononcées par la Cour suprême du Canada en matière criminelle ainsi que des décisions d’intérêt pour l’avocat(e)-criminaliste rendues par la Cour d’appel du Québec?
Aimeriez-vous être informé gratuitement des décisions prononcées par la Cour suprême du Canada en matière criminelle ainsi que des décisions d’intérêt pour l’avocat(e)-criminaliste rendues par la Cour d’appel du Québec?